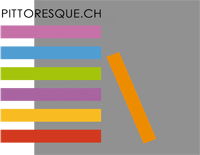Le magasin pittoresque Livres anciens et récents Neuchâtel Suisse Old and antique books Switzerland
Le magasin pittoresque
Bref historique du journal Le magasin pittoresque, paru en France au XIXème siècle - Hebdomadaire populaire dirigé par Edouard Charton
Voici l'éditorial de la première livraison du Magasin Pittoresque en février 1833, cité dans le livre de Marie-Laure Aurenche "Edouard Charton et l'invention du Magasin pittoresque (1833-1870)":
« C'est un vrai Magasin que nous nous sommes proposé d'ouvrir à toutes les curiosités, à toutes les bourses. Nous voulons qu'on y trouve des objets de toute valeur, de tout choix: choses anciennes, choses modernes, animées, inanimées, monumentales, naturelles, au ciel, à tous les temps, venant de tous les pays, de l'Indostan et de la Chine, aussi bien que de l'Islande, de la Laponie, de Tombouctou, de Rome ou de Paris; nous voulons, en un mot, imiter dans nos gravures, décrire dans nos articles tout ce qui mérite de fixer l'attention et les regards, tout ce qui offre un sujet intéressant de rêverie, de conversation, ou d'étude. .... De même, notre Magasin à deux sous, dans un ordre d'entreprise bien différent, se recommande à tout le monde; mais il est plus particulièrement destiné à tous ceux qui ne peuvent consacrer qu'une humble somme à leurs menus plaisirs. Notre grande ambition sera d'intéresser, de distraire; nous laisserons l'instruction venir pas la suite sans la violenter, et nous ne craignons pas que jamais elle reste bien loin en arrière; elle évitera seulement de revêtir les formes arrêtées, sévères, de l'enseignement spécial et méthodique, et son influence s'exercera à la manière de cette éducation générale que les classes de la société riches en loisirs doivent à des relations habituelles avec les hommes distingués, à des lectures variées, choisies, et aux souvenirs des voyages. »
M.-L. Aurenche écrit: « Le ton et la fermeté des propos donnent à cet article le caractère d'un manifeste. Le Magasin pittoresque se donne donc pour ambition de détruire l'ignorance et les superstitions, en se plaçant à égale distance des tentatives de vulgarisation savante qui accompagnent alors le développement de l'instruction, et des manuels de vulgarisation populaire. .... Aussi pour ne pas rebuter, mais amuser leurs lecteurs, vont-ils faire appel aux images. Et l'originalité du Magasin a consisté dans son caractère illustré, rendu possible comme on l'a vu supra, grâce au nouvelles techniques de reproduction des gravures sur bois, importés d'Angleterre. En effet, dans le projet des rédacteurs, les gravures sont tout aussi nécessaires que les mots. .... Force est de constater que cet article liminaire – sans qu'il soit possible d'en attribuer la paternité au seul Charton – a ainsi tracé, d'emblée et sans jamais la modifier, la ligne rédactionnelle de cinquante années passées à diriger le « petit journal à gravures ». Aurenche, pp. 173-174
La dette du magasin pittoresque envers son modèle anglais le Penny Magazine est très grande, comme nous allons encore le constater dans l'article suivant – une citation du Magasin Pittoresque parue dans « La gravure sur bois au XIXème siècle » par Rémi Blachon – ce projet éditorial doit beaucoup à ce qui ce faisait à cette époque en Angleterre:
« Dans les derniers temps (1832), c'est en Angleterre que la gravure sur bois a fait le plus de progrès. Il y a quelques années, on ne comptait que peu de graveurs sur bois en France : leur nombre s'accroît chaque jour à Paris, depuis la fondation des Magasins et depuis la popularité des livres à gravures due au perfectionnement des moyens qui permettent de tirer, à peu de frais et en peu de temps, un grand nombre d'épreuves d'une seule gravure. Un des principaux avantages de la gravure sur bois, ou, si l'on veut, de la gravure en relief, consiste en ce qu'on peut tirer des épreuves conjointement avec les caractères de fonte qui servent à l'imprimerie; et encadrer ainsi à son gré les figures au milieu même du texte, dans les endroits qu'elles servent à compléter ou à expliquer; au contraire, les gravures en taille-douce, présentant les traits du dessin eu creux, exigent un tirage à part très lent, très difficile, et ne fournissent d'ailleurs qu'un nombre d'épreuves beaucoup moins considérable. C'est sur le bois de buis que travaillent les graveurs. On tire une quantité considérable de blocs de bois du Caucase, de l'Égypte, de l'Espagne, du midi de la France, La plus grande partie de ces blocs se vendent aux tourneurs, tabletiers, etc.
On réserve pour la gravure sur bois les plus beaux morceaux taillés perpendiculairement aux fibres du bois, car on ne travaille plus aujourd'hui que sur le bois-debout. Il faut que la surface du bois soit parfaitement polie et qu'il ne s'y rencontre aucun noeud. Souvent lorsqu'il conserve encore de la verdeur ou qu'il est exposé à des températures différentes, le bois travaille et se fend sous la main du graveur; les morceaux réunissant les qualités convenables sont rares et de petite dimension: aussi l'on est souvent obligé d'en joindre étroitement plusieurs ensemble à l'aide de vis pour obtenir une étendue suffisante. En général, le graveur ne dessine point: on lui porte le dessin tracé sur la surface du bois à l'aide de la mine de plomb, de la plume ou du pinceau: les ombres sont formées soit de hachures, qu'on évite autant que possible de mêler ou de croiser pour faciliter le travail des graveurs, soit de lavis ou même d'estompe. Le dessinateur renverse les objets de manière à ce que la surface du bois les représente comme les représenterait un miroir: lorsque le graveur a terminé son travail minutieux et patient, lorsqu'à l'aide de ses pointes il a rigoureusement enlevé, évidé toutes les parties que le dessinateur avait laissées blanches, et mis en relief toutes les lignes tracées ou toutes les parties noires, on encre la surface et l'on applique le papier comme sur des caractères d'imprimerie: le dessin apparaît alors sur le papier tel que l'avait tracé le dessinateur, seulement tous les objets sont de nouveau renversés et paraissent alors dans leur sens naturel.
Une des vignettes du Livre des Métiers (ouvrage rare et curieux, publié à Francfort en 1624) représente un atelier de graveurs sur bois. Le graveur assis devant une table, appuie sa main gauche sur un morceau de bois et burine de sa main droite. Une pointe semblable à celle dont il se sert et une espèce de gouge ou de cisoire sont à côté de lui : rien de plus. Si la curiosité vous conduisait un soir dans l'atelier de l'un des graveurs du Magasin Pittoresque, le tableau qui s'offrirait à vous serait presque aussi simple. Une lampe, des boules de verre comme celles des cordonniers, remplies d'eau colorée en vert par un sel de cuivre, des loupes, de petits coussins circulaires de cuir pleins de sable pour soutenir les bois et nommés en quelques endroits « la troisième main du graveur»; enfin, quelques pointes de dimensions et de formes variées, et peut-être une petite presse à main pour tirer des épreuves, voilà tout ce qui frapperait vos regards. Les pointes ont été successivement améliorées et ont changé de nom. Papillon, dans son Traité historique et pratique de la gravure en bois (Paris, 1766), parle de buttes-avant, de fermoirs nez-ronds, etc. Aujourd'hui, l'on distingue le burin à tracer, qui sert à suivre les contours et à cerner d'un filet extrêmement fin les parties du dessin de teintes différentes; la langue de chat, qui creuse le bois plus profondément; le burin carré et le burin losange avec lesquels on enlève les intervalles de blanc carrés ou losanges entre les hachures; l'échoppe plate, employée pour enlever les petits points carrés ; l'échoppe ronde pour évider les grands fonds blancs; l'onglette, dont la pointe extrêmement fine effleure à peine la surface du bois, fend les tailles ténues en deux, etc. La gravure de la célèbre Vierge à la chaise de Raphaël, que nous opposons au saint Christophe et au valet de carte, est une imitation scrupuleuse de l'une des gravures les plus hardies de Raphaël Morghen. Nous avons laissé en blanc la partie du verso correspondant à la planche, de peur que l'ombre des caractères perçant la feuille, ne se mêle aux traits de la gravure et n'y jette de la confusion. Le genre du dessin n'était pas ce qui convenait le mieux à la gravure en bois; mais toutes ces difficultés qu'il est ordinairement inutile d'imposer au graveur, ont paru de nature à faire ressortir 1e progrès accompli depuis quatre siècles dans la gravure populaire.
Cette planche a été exécutée par l'un des meilleurs graveurs en bois de notre temps, par M. Jackson; c'est à lui et à MM. Andrew, Leloir, Best, Quartley, Sears, Lee, etc., que sont dues toutes les gravures du Magasin Pittoresque. L'extrême patience et l'incroyable adresse nécessaires pour conserver cette multitudes de blancs à peine saisis par l'œil, ne peuvent être que difficilement appréciées. Le procédé du graveur en taille-douce qui suit seulement et coupe de la pointe les lignes du dessin, est loin d'être aussi ingrat. [...] Nous terminerons les détails qui concernent la fabrication d'une livraison du Magasin Pittoresque, en disant quelques mots du stéréotypage. Lorsque les gravures en bois sont encadrées dans la forme avec les caractères mobiles, on pourrait livrer cette forme aux Pressiers, qui la mettraient sous la Presse mécanique. Mais chaque tour des cylindres ne donnerait qu'un exemplaire. Ainsi, en raisonnant sur 100 000 exemplaires de chaque livraison, i1 faudrait, puisque le Magasin paraît une fois la semaine, qu'on en tirât environ 17 000 par jour de travail; ce qui, en supposant qu'on travaillât jour et nuit sans perdre un instant, exigerait un tirage de 700 livraisons par heure. Sept cents livraisons par heure ! cela est possible; une machine simple en tire régulièrement 800. Mais si l'on fait entrer en ligne de compte le temps de la mise en train, les momens de chômage nécessaires pour remédier aux mille petits accidens de détail qu'il faut surveiller avec le soin le plus minutieux; si l'on réfléchit, d'une part, à la presque impossibilité de maintenir les machines â vapeur sans réparations dans un travail aussi rigoureux, et de l'autre, aux frais énormes qu'entraînerait un service d'ouvriers assez nombreux pour résister à des fatigues si continues, on voit qu'en travaillant les nuits et même les dimanches, i1 serait fort difficile d'atteindre à un tirage de 100 000 par semaine; ce qui limiterait forcément la quantité de souscripteurs auxquels aurait droit de prétendre un recueil populaire.
Mais la difficulté du temps nécessaire au tirage ne serait pas la seule; les gravures en bois seraient notablement avariées, gâtées et même détruites, long-temps avant d'avoir essuyé cent mille fois les pressions du cylindre, et cent mille fois le frottement des trois rouleaux à encre. Il y aurait bien un moyen de remédier à ces inconvéniens, ce serait de faire une seconde, une troisième composition, et de graver chaque dessin sur un second, un troisième morceau de bois; on aurait ainsi deux ou trois formes semblables que l'on soumettrait à deux ou trois presses mécaniques. Mais que de dépenses i Il y a telle de nos grandes gravures pour laquelle on a dû payer plus de SIX CENTS FRANCS; il faut bien des DEUX SOUS pour couvrir ces énormes frais, qu'il ne serait pas prudent de doubler ou de tripler. C'est dans ces circonstances que le stéréotypage vient prêter à l'imprimeur son utile secours : cette opération consiste à reproduire, par l'empreinte, un certain nombre de fac-simile de la forme. Voici les détails principaux de cette opération. Chaque page de la livraison du Magasin Pittoresque, caractères et bois gravés, est mise dans un châssis en métal. Un premier enduit d'un corps gras est passé sur la page, puis avec un pinceau on applique une bouillie liquide formée avec du plâtre de Montmartre, tamisé au tamis de soie le plus fin possible. Le plâtre de Montmartre (gypse) est le meilleur pour cet usage; c'est aussi celui qu'on emploie à Londres. Avec une seconde brosse dure et fine on frappe légèrement sur la bouillie pour la faire pénétrer dans les traits les plus déliés des caractères ou du bois gravé, puis on verse sur le tout une couche de cette même bouillie de plâtre jusqu'au niveau d'un second chassis mobile, dont on a entouré le premier pour maintenir le plâtre à l'épaisseur voulue. On laisse durcir le plâtre ; on l'enlève de dessus les caractères, et on a le moule ou matrice qui est une contre-épreuve où la page du Magasin est à l'envers de ce qu'elle était sur le caractère mobile et les bois.
Cette matrice est placée dans un four fortement chauffé pour être tout-à-fait séchée. Cette contre-épreuve va nous donner maintenant une épreuve redressée. Voici comment: on la renferme dans une boîte en métal percée de deux trous, que l'on plonge dans une chaudière remplie d'un alliage de plomb et d'antimoine, le même qui sert à la fabrication des caractères. Cet alliage est tenu en liquéfaction par la chaleur; il entre dans la boîte et s'empreint sur le moule en plâtre, puis il est soumis à l'action du ra fraîchissoir qui détermine la formation de la planche avec tous ses déliés. Il ne s'agit plus que de casser le moule de plâtre, et de livrer la planche métallique, que l'on désigne généralement sous le nom de cliché au piqueur. Le piqueur est chargé de suivre scrupuleusement toutes les lignes du texte, et aussi les détails de la gravure; son travail exige beaucoup de soin et de précision. Ainsi, par le procédé de stéréotypage, on a obtenu une épreuve de métal, un cliché exactement semblable à la page sur mobile. Rien n'empêche d'en prendre ainsi une deuxième, une troisième, une quatrième. On peut donc avoir plusieurs fac-simile d'une livraison du Magasin Pittoresque, et employer au tirage autant de presses que cela est nécessaire. La Presse mécanique dont nous avons donné la description est assez grande pour que la table (ou le marbre) puisse recevoir, à côté l'un de l'autre, deux clichés de la même livraison; on obtient ainsi deux livraisons d'un même coup de presse, c'est-à-dire 1 600 livraisons par heure; elle peut à elle seule livrer pendant la journée de travail environ 17 000 livraisons. D'ailleurs on a des clichés de rechange, et lorsque les traits de la gravure commencent à perdre de leur netteté par suite des pressions du cylindre, on substitue un cliché tout neuf au cliché usé. »
Deux livres incontournables pour apprécier l'édition du Magasin pittoresque et l'activité éditoriale du XIXème siècle en général:
Marie-Laure Aurenche, Edouard Charton et l'invention du «Magasin pittoresque » (1833-1870) honoré champion, Paris, 2002
Remi Blachon, La gravure sur bois au XIXème siècle Les Editions de l'Amateur, Paris, 2001
haut de page